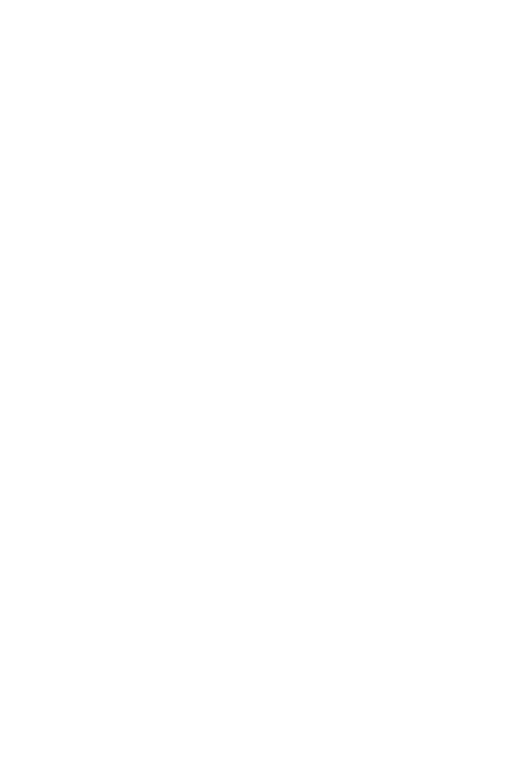Des rats de plus en plus nombreux malgré des actions intensives
Un récent article de la RTBF signale une prolifération préoccupante de rats dans les parcs bruxellois, et ce malgré la multiplication des campagnes de contrôle menées par la ville. Selon cette source, la Ville de Bruxelles a déjà mené plus de 260 interventions ciblées depuis le début de l’année. Il suffit pourtant de se promener dans certains parcs de la capitale pour apercevoir des rats en plein jour, signe que ces animaux restent très présents sur le terrain. En d’autres termes, la simple augmentation du nombre d’interventions ne semble pas endiguer durablement le phénomène.
Les limites des approches traditionnelles
Ce constat met en lumière l’inefficacité relative des méthodes traditionnelles de gestion de la population de rats lorsqu’elles sont employées de manière ponctuelle et non coordonnée. Souvent, les interventions classiques consistent à placer des appâts empoisonnés (rodenticides) ou des pièges dans une zone identifiée comme problématique, en réaction à une observation signalée. Bien que cette approche puisse réduire temporairement le nombre d’individus visibles, elle ne traite pas la cause profonde et permet aux populations de se reconstituer rapidement. Le rat brun (ou surmulot) possède un potentiel de reproduction élevé : une femelle peut avoir plusieurs portées par an (en général en nature 3 à 5 portées pour 7 à 8 individus par portée). La durée de gestation est très courte (22 jours) avec une maturité sexuelle atteinte très tôt : entre 50 à 60 jours, ce qui permet au groupe de retrouver ses effectifs en quelques mois seulement après une campagne de lutte. Tant que le milieu reste propice – présence de déchets alimentaires, accès à des abris – de nouveaux individus viennent combler le vide laissé par ceux qui ont été éliminés.
Le manque de coordination et de suivi
Un autre problème des interventions ponctuelles est le manque de coordination et de suivi à long terme. En multipliant les opérations isolées sans stratégie globale, on obtient un effet dispersé : on traite un foyer ici ou là, mais les rats des foyers avoisinants peuvent simplement migrer vers les zones traitées lorsqu’un vide est créé. Chaque quartier ou parc est souvent géré, sans planification centralisée, ce qui réduit l’impact global. De plus, la répétition de traitements chimiques peut entraîner une accoutumance aux type d’appâts utilisés (baisse d’appétence) ou la sélection de souches résistantes aux substances actives, rendant les appâts traditionnels moins efficaces au fil du temps. A titre d’exemple, sur 9 molécules autorisées sur le marché européen, une résistance est documentée pour 5 d’entre elles (voir article de blog sur le challenge efficacité, résistance et écotoxicité à venir). En résumé, multiplier les actions ne signifie pas améliorer l’efficacité : sans approche cohérente et préventive, ces campagnes répétées reviennent à « vider la mer à la petite cuillère », avec des résultats éphémères et un éternel recommencement.
Des implications sanitaires, environnementales et économiques considérables
Les rats endommagent les infrastructures, consomment les récoltes agricoles et contaminent les stocks alimentaires, causant des dégâts estimés à 27 milliards de dollars par an rien qu’aux États-Unis (1). Les rats abritent également et transmettent plus de 50 agents pathogènes zoonotiques et parasites à l’homme, affectant la santé publique dans le monde entier. Les maladies associées le plus couramment comprennent la leptospirose, le syndrome pulmonaire hantavirus, le typhus murin, la peste bubonique, les salmonelloses et les campylobactérioses. Les rats prospèrent dans les paysages dominés par l’homme en exploitant les ressources concentrées là où la densité de population humaine est élevée, notamment dans les environnements urbains. En conséquence, les densités de population de rats devraient être plus élevées dans les villes que dans les zones rurales, avec le potentiel d’affecter davantage de personnes. La simple présence de rats a également un impact mesurable sur la santé mentale des personnes vivant en contact avec eux (2).
Les municipalités et les propriétaires privés tentent de réduire le nombre de rats depuis des siècles. Au cours des dernières décennies, les efforts ont principalement été réalisés par l’utilisation de produits chimiques rodenticides létaux ou de pièges, plutôt que par des options non létales qui rendraient l’environnement moins propice (par exemple, sécuriser les déchets alimentaires et réduire les habitats favorables aux rongeurs). À l’échelle mondiale, les efforts de lutte associés à cette « guerre contre les rats » coûtent environ 500 millions de dollars chaque année (3). Au niveau municipal, les stratégies et l’intensité de ces efforts de contrôle varient considérablement d’une ville à l’autre. Le contrôle des rongeurs doit s’adapter en permanence au sein des villes au fil du temps, les priorités évoluant, les budgets et le personnel fluctuant, et de nouveaux produits ou approches de contrôle étant introduits.
Repenser la stratégie : vers une approche préventive
Le défi bruxellois illustre un problème plus général dans nos villes : la nécessité de passer d’une lutte curative et ponctuelle à une approche de contrôle des populations de rats plus préventive et continue. Le contrôle des populations de rongeurs se doit d’être anticipé et non subi. C’est précisément dans cette optique qu’émergent de nouvelles solutions innovantes, comme celle développée par Secu-Rat.
Secu-Rat : une solution connectée pour un contrôle durable de la population de rats
Pour relever ce défi, Secu-Rat propose un dispositif intelligent et breveté s’inscrivant dans une démarche préventive. Cette solution connectée repose sur une approche ciblée, monitorée et proactive, en contraste avec les méthodes traditionnelles. L’idée maîtresse est d’agir dès l’apparition des premiers individus, afin d’éviter que la population ne se développe. Le système permet de surveiller en continu les sites sensibles et de déclencher une intervention immédiate après la détection du tout premier rat. En plaçant des capteurs sous les corbeilles de propreté, on obtient un suivi précis de l’activité et on peut intervenir à la source sans attendre l’infestation.
Les atouts clés de l’approche Secu-Rat :
- Détection précoce et intervention rapide : Grâce à des capteurs connectés, le dispositif repère le premier individu dès son apparition. Cette vigilance continue garantit un contrôle anticipé, avant que les rats ne s’installent durablement.
- Réduction des appâts chimiques, recours au piégeage mécanique : Le recours aux rodenticides est fortement limité, au profit parfois du piégeage mécanique, plus respectueux de l’environnement.
- Prévention durable : En empêchant la prolifération, la solution est plus éthique. Moins d’interventions létales sont nécessaires, car la population reste maîtrisée dès le départ.
- Monitoring en temps réel et données terrain : La solution s’inscrit dans une logique connectée. Les gestionnaires disposent d’informations précises et peuvent adapter leur stratégie sur la base de données fiables, pour un pilotage intelligent.
- Démarche IPM (Integrated Pest Management) : Le dispositif Securat respecte les principes de la gestion intégrée : prévention, surveillance, traitement ciblé, évaluation continue. Il s’intègre facilement dans une politique de gestion globale de la population de rats.
Des résultats concrets et reproductibles
En pratique, Secu-Rat transforme les corbeilles de propreté en outils intelligents de contrôle. Le dispositif, placé sous les poubelles existantes, empêche l’accès aux déchets tout en captant l’activité des rongeurs. Ce concept innovant a déjà séduit plusieurs villes françaises ou étrangères (Toulouse, Nice, Lyon, Rouen, Angers, Reims, Besançon, Selestat, Zurich…) qui constatent une réduction significative des présences sur le terrain. Par exemple, dans une zone urbaine dédiée au pique-nique équipée de cinq corbeilles de propreté, la population de rongeurs est passée de plusieurs dizaines d’individus observés quotidiennement—au point que les agents de propreté refusaient de vider les corbeilles par crainte de morsures—à une situation où aucun signalement de présence n’a été rapporté par les riverains ou les usagers du parc. Aujourd’hui, moins de cinq individus par an sont capturés grâce aux dispositifs Secu-Rat, ces captures correspondant à des animaux en phase de recolonisation, interceptés avant leur installation durable et leur reproduction. En s’appuyant sur une technologie connectée et une stratégie préventive, Secu-Rat redonne aux collectivités les moyens d’un contrôle durable et éthique de la population de rats, loin des logiques réactives peu efficaces.
Une transition nécessaire pour les villes
En conclusion, l’augmentation continue des rats dans les parcs bruxellois, malgré des efforts considérables, démontre la nécessité de changer d’approche. Plutôt que de multiplier indéfiniment des actions curatives aux résultats mitigés, il est plus efficace d’opter pour une stratégie connectée et intégrée. La solution Secu-Rat illustre parfaitement cette nouvelle voie : grâce à une surveillance intelligente, une réduction de l’usage des produits rodenticides et une action préventive dès les premiers signes de présence, elle offre aux villes un outil puissant pour reprendre l’avantage face aux rats. Ce passage à une gestion proactive de la population de rats pourrait bien représenter l’avenir du contrôle en milieu urbain, pour des espaces publics plus sains et des parcs à nouveau sereins
REFERENCES CITEES
- D. Pimentel, Environmental and economic costs of vertebrate species invasions into the United States, in Managing Vertebrate Invasive Species (USDA, 2007).
- K. Byers, C. Himsworth, R. Lam, Beyond zoonosis: The mental health impacts of rat exposure on impoverished urban neighborhoods. J. Environ. Health 81, 8–13 (2018).
- C. Diagne, L. Ballesteros-Mejia, R. N. Cuthbert, T. W. Bodey, J. Fantle-Lepczyk, E. Angulo, A. Bang, G. Dobigny, F. Courchamp, Economic costs of invasive rodents worldwide: The tip of the iceberg. PeerJ 11, e14935 (2023).